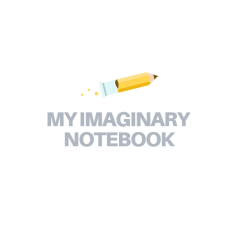Je traversais les restes du cours Alsace Lorraine. Un itinéraire plus sur après l’effondrement de la tour. Le bruit allait surement rameuter des gangs ou des horreurs des guerres des hypothèses. Je préférerais être loin quand tout ce joli monde tiendrait un meeting sur la place. Dans la grande artère je verrais arriver les ennuis de loin et ne risquais pas de tomber dans une embuscade. J’avais l’habitude de prendre par les rues autour de la place Caju mais les immeubles pouvaient encore s’écrouler. Mes besoins physiologiques m’obligeant à presser le pas, je n’avais pas envie de perdre du temps dans une ruelle bouchée par les éboulis.
J’avançais d’un pas rapide à l’affut du moindre bruit. Je ne percevais que le crissement de mes bottes sur les gravats. Il ne restait plus que quelques éparses pierres blanches pour rappeler ce qu’avait été le cours. Avant les guerres, le ciment et le verre avaient englouti le minéral clair. Tout avait depuis été soufflé par des siècles de blast. Des centaines d’années de poussière séparaient mes pieds des pavés originels.
[Sur les pavés, la guerre].
J’arrivais sur les quais. Le port du croissant de lune avait pris un coup de vieux. Les conflits avaient creusé le lit du fleuve, changé ses courbes, étalé ses eaux. On était maintenant plus près du quartier de lune massacré à la météorite que du beau croissant de boulanger.
Mais Monsieur l’astre solaire se couchait là-dessus. Et c’était beau.
Et que bim je te transforme la pierre en miel doré et que je te tartine les nuages de confiture rose.
Sur le pont des matières les insomniaques allumaient les braseros pour la nuit. Jadis pont de pierre, il avait été rebaptisé à force d’être détruit et reconstruit dans des matériaux différents. Il se dressait sur cinq niveaux, fait de bois, de métal, de plastique et de béton. On ne pouvait plus que deviner les piliers de pierre originels sous l’amas de matières hétéroclites. La lumière du couchant faisait briller les formes alambiquées de la structure d’un éclat trompeur. Bientôt la nuit recouvrirait le pont de son déguisement de monstre brisé flottant sur les eaux noires de la Garonne. C’était l’unique passage permettant encore de relier les deux rives. Les insomniaques se relayaient pour monter la garde en permanence. Je suivais le fleuve et passais à côté des antédiluviens rails de tramway qui émergeaient du sol stratifié par le temps. Les deux lignes parallèles n’avait su rester à leur place. L’histoire les avait tordues comme un forain s’exerçant sur des barres de fer. Les rails n’étaient plus collés au sol, ils s’élevaient en une pente douce vers le ciel. Un tremplin d’acier de plusieurs dizaines de mètres de haut pour qui voudrait jouer à l’homme canon. Adolescents l’un de nos grands jeux était de voir qui escaladerait le plus haut les rails. Des petites stries faîtes à la craie attestaient des performances de chacun.
Cinq minutes de marche rapide plus tard je me retrouvais devant la porte ouest.
Nos ingénieurs avait assemblé le squelette de Bordeaux pour faire nos remparts. Poutres de métal et béton découpé. Nous nous étions installés à l’intérieur de ce qui avait été il y a bien longtemps la ville médiévale. Les décombres étaient devenus nos fortifications, la Garonne nos douves, les bâtiments de la place de la bourse notre donjon.
Aucun mouvement n’était perceptible en haut des murailles. Quinze mètres de métal immobile et silencieux se dressaient devant moi. En prévision de ce qui allait suivre je ramassais quelques pierres, un peu pointues mais pas trop.
-Kévin ouvre. Je suis pas d’humeur. Je sais que tu m’as vu arriver.
-La France t’as entendu arriver Roude. Tu fais un bordel pas possible et tu te pointes juste après. Les bêtes vont tourner toute la nuit après ça.
Kévin, Kévin, Kévin. Tu me fais le coup à chaque fois que t’es de garde. T’as juste envie de passer le temps et si tu m’ouvres toute suite, tu sais que je vais pas rester tailler le bout de gras.
-C’est pour ça qu’on a des murailles Kévin.
-C’est pas toi qui va devoir veiller les gangs toute la nuit gamine.
-On est obligé de jouer à ce jeu-là à chaque fois ?
-Viens faire une garde une fois, rien qu’une fois. Ça te feras les pieds. T’es trop bien pour surveiller le fort toi hein ?
Pour appuyer son propos il passa sa tête par-dessus le parapet. Des yeux tombant, un visage mou et une bouche un peu de traviole qui semblait toujours sourire apparurent en haut du mur.
Kévin, Kévin, Kévin. C’est toi qui m’y oblige.
Ma première pierre fit siffler ses oreilles.
La deuxième toucha son but mollement.
La troisième fit sonner son casque.
Après un chapelet d’insultes sur lequel on aurait pu prier les portes se refermèrent enfin derrière moi. Le bruit résonna dans les rues vides. J’arrivais devant l’une des entrées de Fort du croissant. Amarrés au toit du fort par des câbles, les ballons gonflés à l’hélium flottaient. Les signaux d’alerte changeaient de couleurs selon le degré de menace. La présence d’un Diamantaire les avait fait virer au rouge. Ils donnaient l’impression qu’un géant avait planté d’immenses coquelicots sur les toitures. De carmin ils allaient vite repasser au bleu maintenant que le danger était écarté. Devant la porte, sur son éternel tabouret en bois, Wool m’attendait. Il tricotait, comme d’habitude, vêtu de son armure décorée de fils de laine multicolores. Le kevlar bleu nuit disparaissait sous les échantillons de chaque pelote qu’il avait utilisé, la solide armure ensevelit sous des couleurs bigarrée. Son visage, meurtri par l’histoire, demeurait toujours caché par un masque renforcé, laineux lui aussi. J’adorer voir ce monstre pelucheux tricoter.
-Z’étaient combien ? Me questionna-t-il
-Trois dont un costaud.
-Leurs mirettes ?
En me parlant il posa le pull qu’il tricotait sur mes bras, prenant tranquillement ses mesures. Je lui avais commandé un pull noir et or un mois plutôt.
– Deux avec les yeux noirs et un autre tu l’aurais vu ! Les yeux rouges coupés en deux ! Répondis-je.
– C’est pt’être qui l’avait pris de l’eau d’en dessous ?
J’entendais la voix douce de Wool à travers son masque. J’adorais sa manière de hacher les mots comme si sa bouche aussi était de laine. Il parlait un français tinté d’un accent d’avant, hérité d’un lieu lointain appelé « la Nouvelle Orléans ». Le cajun passé au filtre de son masque rendait son élocution inimitable. Quand les attaques avaient commencé d’autres guerriers plus expérimentés que moi m’accompagnaient. Aucun n’avait su percer les armures des diamantaires. Maintenant il n’y avait plus que Whool. Je sortais danser et lui attendait. Souvent, quand tuer avait été trop dur, trop sale, je m’asseyais sur un deuxième tabouret. Il me tendait un crochet et nous enlacions les mailles en attendant la nuit, en attendant que mes chansons préférées transformées en requiem sortent de ma tête.
– Non, il était trop rapide pour ça. La rouille ça donne de la force mais pas autant de vitesse. Il a porté deux épées d’un coup ! J’ai failli y perdre une fesse !
– C’est une nouvelle tambouille alors ? demanda-t-il
– Un mélange de plusieurs sinon ?
– ‘Sais pas. ‘Sais pas d’où ils viennent et ‘sais pas d’où ils tirent cette force. Damne on sait même pas si ils sont humains. Ce serait des poulets épicés en armure on le serait pas ! ‘Aime pas que tu sois la seule à partir te bagarrer cont’ ces machins. Et le brouhaha ? Qu’as-tu cassé encor’ ? M’interrogea Wool.
Je savais pertinemment que lors de mes « chorégraphies » il m’observait toujours. Caché dans un immeuble, immobile sous une arche, il se tenait prêt à se sacrifier pour me sauver. Je savais qu’il savait que je savais mais nous jouions toujours au jeu de « je-ne-sais-pas-ce-qui-c’est- passé-raconte-moi ». J’ignorais comme il arrivait à chaque fois à revenir sur son tabouret avant que je rentre.
– Rien de moins que la tour Peyberland. J’ai peut-être un peu merdouillé sur la discrétion et les Diamantaires ont décidé de changer l’architecture de la place.
– ‘Tenait plus debout de toute façon cette tour, à l’époque elle était deux fois plus grande. T’as un peu forcé sur le maquillage ?
Mes joues revisitées à l’éclat de pierres taillées ne lui avaient pas non plus échappées.
– J’avais envie de changer ! Je te retrouve chez le général ? J’y serais dans une heure.
Wool acquiesça.
– J’Prépare les encres.
Je le serrais rapidement contre moi et me dirigeais vers l’intérieur du bâtiment.
– Et j’attends mon pull honorable yéti !
– Ça arrive ! ‘me fait chié avec les mailles serrés mais ça arrive !
***
J’étais passé dans ma chambre où j’avais entre autre pris une douche et m’étais changé. Je traversais maintenant les bâtiments du Fort pour honorer mon rendez-vous chez le général. J’avais attendu patiemment sous l’eau tiède que le contrecoup de la danse disparaisse un peu. Je sentais monter le brouillard, demain matin allait être compliqué. J’avais trainé pour laisser les notes sortir de ma tête. J’avais même pris le temps pour une fois de choisir ma tenue, le temps que les hallucinations auditives s’estompent. J’avais essayé d’arranger mes cheveux, les avoir laissé pousser me plaisait bien mais compliquait ma vie capillaire. Mes cheveux châtains, coupés en carré, avaient tendance à avoir leur volonté propre. Je m’étais même questionné sur quel bijou m’accrocher dans les cheveux ! [J’avais opté pour ma flèche dorée, pour ceux du fond que ça intéresse] J’avais troqué mon armure de kevlar noir contre un débardeur blanc et un pantalon brun. Malgré mes efforts les journées à m’entrainer m’avaient affublé d’un joli teint cireux. Je retrouvais dans le miroir une trombine que je n’aimais que modérément. Mon nez trop long, mes yeux trop marrons et mon visage trop lui-même. Les éclats de pierre m’avaient laissé une belle balafre sur la joue. Mon reflet avait confirmé mon ressenti, Madame la fière guerrière avait une sale gueule. Je ne savais pas combien de temps j’allais pouvoir tenir ces monstres loin de Fort du Croissant. Aujourd’hui ils étaient trois, un de plus que la dernière fois. Leur nombre et leur force croissaient. Mes talents me permettaient d’atteindre les infimes interstices dans leurs armures mais mon nombre à moi ne variait pas d’un iota. Je ne sais pas combien de temps je réussirai à éviter un nouveau massacre. Trois ans déjà que le premier des diamantaires avait surpris la garde du matin à la porte est. Ils avaient pensé à un membre égaré d’un club ou à un soldat de la FMC. Le temps qu’ils se décident à descendre, le monstre avait fait une percé dans un des murs. Le diamantaire avait massacré vingt personnes avant qu’une solution soit trouvée pour l’arrêter.
Un bruit de griffes raclant le parquet me tira de mes pensées.
Un cri entre l’aboiement et le miaulement résonna dans le couloir. Léonard se tenait devant moi, ses yeux de volailles me fixant avec l’amour inconditionnel propre aux animaux de compagnies. Il frotta son bec contre mon pantalon. C’était un dodo au plumage noir, ramené des limbes des espèces disparues par des expériences plus au moins réussies. La créature hantait nos bâtiments et plus particulièrement ma chambre depuis des années. Je m’étais prise d’affection pour cette grosse poule affectueuse et il me le rendait bien. Quand je rentrais de mes excursions je le trouvais souvent couché sur mon lit, laissant ses plumes sombres aux quatre coins de mes draps. Je ne sais pas comment s’était passé sa création mais ce volatile avait surement été croisé avec différents animaux domestiques pour avoir un cri entre l’aboiement et le miaulement et un caractère de labrador. Les enfants du fort l’avaient nommé Léonard.
J’arrivais à « l’état-major », la chambre du général. Le dodo gratta la porte close en couinant.
J’entrais.
Léonard alla directement s’allonger aux pieds de Wool. Mon yéti protecteur était en grande conversation avec un immense personnage vêtu d’une chemise bleue marine interminable. Alceste Jahil dit « le général » avait des bras démesurés qui brassaient l’air autour de lui en permanence. La pertinence de ses discours n’avait d’égal que l’énergie déployée par son corps pour appuyer ses propos. Ses fines lunettes cuivrées passaient leur temps à essayer de fuir l’arrête de son nez dévoilant son regard pétillant. Lorsque ses longues diatribes était terminées, il remontait ses lunettes d’une main, passait la main dans ses cheveux crépus et vous observez longuement pour voir si vous aviez saisi les mots prononcés. De nombreuses fois je l’avais vu déclarer après une minutieuse analyse de son interlocuteur « Vous ne m’avez pas compris ». Alors Alceste Jahil reprenait son discours et choisissait avec soin chaque nouveau mot prononcé afin que la personne en face comprenne. Et elle comprenait toujours. Jamais il ne renonçait. Je vouais un profond respect à ce géant noir en pyjama qui avait semble-t-il recueilli le savoir et la patience de tous les géants de la terre.
– Bonjour général.
– Bonjour Gertrude. Je suppose que tu te laisses peindre par notre ami crocheteur avant notre partie. Le général et lui seul était autorisé à m’appeler par mon prénom. Le commun des mortels me nommait Roude et ne connaissait pas mon merveilleux et mélodieux prénom.
– Si cela ne vous dérange pas trop général. Répondis-je.
– Un esprit sain dans un corps peint. Déclara-t-il.
Wool avait préparé le matériel pour notre petit rituel. Pour chaque Diamantaire tué il me tatouait une goutte de pluie de la couleur des yeux du défunt. J’avais maintenant une averse colorée dans le dos et sur les épaules. Chaque goutte était une chanson en moins à mon répertoire, une marque des amputations faîtes à ma playlist. Ce jour-là ce fut deux gouttes noires et une goutte rouge fendue en deux. Je m’asseyais sur un tabouret. Les trois motifs seraient sur mon épaule droite. Léonard changea de refuge pédestre en émettant un ronronnement contrarié et partit se lover contre le général.
L’aiguille rencontra la chair.
– Vas-tu à la petite sauterie organisé pour le mouvement ? Me demanda Alceste par-dessus le vrombissement de la machine.
– Peut-être général.
– Ce serait un choix judicieux Gertrude, bambocher un peu ne pourras pas te faire de mal.
Je souriais. Sa manière à lui de me dire que j’avais une sale tête et besoin de me changer les idées.
– Je vais réfléchir à votre conseil avisé. On parle de qui aujourd’hui ? Demandais-je
– Paul Hockaleuk le réalisateur. Répondit-il en sortant une photographie noir et blanc d’une boîte métallique.
– Encore un mec sympa ?
– Dante aurait pu inventer un dixième cercle juste pour lui.
Dans la chambre du général nous jouions aux fléchettes.
Lui pour parler.
Moi pour écouter.
Nous suivions toujours le même rituel,
Je m’allongeais sur le grand tapis rouge et violet après mon tatouage.
Le ventre contre le tissu réconfortant j’attendais mon morceau d’histoire. Le général piochait dans sa boîte un portrait qu’il affichait sur la cible.
La boîte était remplie de photos de généraux, de dictateurs, d’empereurs, d’esclavagistes, d’inventeurs fous, de tortionnaires. La lie de l’humanité contenue dans un mètre cube.
Staline, Goering, Pernote et autres scientifiques des guerres des hypothèses attendaient leurs tours. Le visage des meurtriers remplacés les ronds noirs et rouges du cadre en bois.
Des saccageurs de vies.
Des violeurs d’humanités.
Des destructeurs de lendemain qui recevaient des volées de petites flèches d’aciers.
Mais avant que nous crevions les yeux, trouions les gorges, percions les joues grasses des éminences noirs de l’histoire, le général parlait.
Il contait, racontait et recomptait les morts de l’Histoire.
Avec sa voix grave, qui n’avait pas daigné se laisser toucher par l’âge, il vous emplissait les oreilles d’avant. Ça remontait jusqu’à la rétine pour ancrer de l’histoire dans la réalité de vos neurones.
J’avais, dans cette pièce, senti, presque touché les obus de toutes les guerres. J’avais senti le bois rance des bateaux d’esclavagistes, fais dans mon froc dans les tranchées. J’avais même crié à la mort de mes ennemis sur les plaines des guerres blanches. J’avais cru mourir cent fois par balles, flèches et lances.
Surtout j’avais aimé le poilus, le résistant, le mamelouk et j’en passe et des morts. J’avais, par les contes du général, compris la douleur des soldats.
Et tous les deux,
Lui, la fléchette alerte (car le Général gagnait toujours),
Moi, l’oreille ouverte.
Nous avions pleuré.
A deux.
A tout seul en silence.
A tous en échos
Nous avions crachés par les paupières la douleur de la grenade qui explose, de la balle qui tue, de la flèche qui t’ôte les futurs radieux.
La légende racontait que le général allait tous les matins uriner sur un obus centenaire planté dans une cour secrète où étaient gravés les vers de Prévert :
« Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement »
– Quelle période celui-là général ? »
– Il s’est illustré pendant les guerres des hypothèses.
Inconsciemment je me crispais, mes doigts agrippèrent les poils du tapis, mes pieds se tendirent. Cette période était une des nombreuse que l’histoire aurait pu s’abstenir de nous faire vivre. Rien que le nom de cette période, englobant trois années de drame, me chavirait les souvenirs, me mettait les sentiments au bord des lèvres.
– Ça ira pour toi Gertrude ? Me demanda le général
– On fera avec général.
Le général commença à raconter. Une fléchette dansant entre ses doigts, passant de phalange en phalange, il énonça les faits :
– Après le « Grand-Cessez-Le-Feu », quand les armes à feu disparurent, les hommes au lieu de réfléchir à un armistice général continuèrent leurs guerres sans buts. Si les armes à feu furent interdites il restait de nombreux moyens d’ôter la vie. Comme tu ne le sais que trop bien les états restants et autres armées indépendantes se lancèrent dans une course effrénée à l’armement non balistique. Des horreurs sans nom furent inventées et testées pour remplacer fusils et canons. Chaque scientifique fou pu tester ses hypothèses sur les champs de batailles. Encore aujourd’hui on ne connait pas l’ensemble des abominations inventées pendant cette période.
A grand coup d’armes bactériologique immonde et de modification génétiques on créa d’immenses no man’s land, espaces de guerre vérolés par les sciences mises au service de la bêtise. Quand le monde en eu marre d’être un laboratoire à ciel ouvert pour savant fou, on trouva comme toujours un troupeau de boucs émissaires. Les scientifiques, toutes spécialités confondues, accusés de l’ensemble des maux de la terre, furent massacrées. Il ne resta plus que les haches et les épées pour s’entretuer, des batailles des hypothèses on passa aux guerres blanches. Le métal froid remplaça le bidouillage moléculaire. On se réessaya à la guerre de cent ans en l’an de grâce 2270.
Le général afficha le portrait de Hockaleuk sur sa cible. Je m’étais toujours demandé où il trouvait ces photographies.
– Notre ami s’illustra pendant les guerres des hypothèses et les guerres blanches, dans un grand mélange d’armes moyenâgeuses et de fin de guerre bactériologique. Ne te fit pas à son regard clair et à ses fossettes Gertrude, derrière ce visage se cache encore une fois un cerveau malade. Après un engagement frileux dans les dernières guerres poudreuses, il fut un des fervents détracteurs du Grand-cessez-le-feu, caution scientifique des partisans des armes à feu. Médecin et psychologue de formation c’était un homme charmeur et charismatique. Juste avant que les guerres des hypothèses éclatent, des rumeurs entourant son cabinet émergèrent, des patients disparus ou victimes de pathologies surprenantes après leurs passages chez lui.
Mais Hockaleuk avait senti le vent tourner.
Sentant son heure de scientifique sonnée à l’horloge atomique de sa vie, il voulut tester ses théories avant la fin. Paul Hockaleuk tenait à prouver, à qui on se le demande, que l’image avait plein pouvoir sur le cerveau humain. Passionné par les tortures de toute sorte, il désirait montrer que les outils et supplices compliqués ne servaient à rien, qu’on lui donne un écran et il briserait le plus réticent des espions. Il se fit engager par les différents belligérants du conflit qui financèrent ses recherches. Il obtint des résultats sans précédent dans l’extorsion d’aveux. Le procédé était aussi simple que cruel, montrer à un homme les images d’un corps découpé, haché, brisé en lui faisant croire que c’était le sien. Ses victimes étaient d’abord paralysées de l’ensemble du corps puis bourrées de psychotropes pour faciliter le processus. Hockaleuk leur montrait ensuite des images de leur corps découpé méthodiquement sans qu’il ne puisse bouger le petit orteil. Quand chaque parcelle d’information avait été arraché, il laissait à ses « patients » le soin de découvrir la supercherie. Un corps intact mais ses secrets les plus noirs avoués. Sa grande fierté était bien sûr de briser les gens sans leur infliger la moindre douleur physique. Paul Hockaleuk rendit fou à lier 179 personnes en deux ans et demie. Des malheureux que l’on retrouvait paralysé d’un membre qu’ils pensaient amputé. Des hommes et femmes passaient le reste de leur vie persuadés d’être brulé sur l’ensemble du corps ou terriblement défiguré. Sur les champs de bataille certains soldats se suicider plutôt que d’être fait prisonnier et de subir le supplice de « l’amputation fantôme ».
– Et pourquoi le surnom de « réalisateur » ?
Wool émit un petit grognement amusé entre deux mailles.
– Parce qu’il ne s’est pas arrêté là Gertrude. Fort de son succès de tortionnaire il voulut passer au niveau supérieur. Sa fascination malsaine pour les écrans le poussa toujours plus loin dans la folie. A la fin des guerres des hypothèses, il réussit à échapper aux purges scientifiques. Il devint conseiller des seigneurs de la Grande Aquitaine pendant les guerres blanches. Il les convint de le laisser tester une de ses inventions pendant le siège de Bordeaux. Il voulait appliquer sa technique de manipulation par les images à l’échelle d’une armée. Il créa de toute pièce des images de l’armée adverse se faisant tailler en pièce par les bordelais. Le réalisateur passa des semaines sur son œuvre morbide. Le film était saisissant de réalisme. Les gros plans montraient des soldats mourants dans des souffrances indéfinissables. On lança la construction d’immenses écrans face aux assaillants pour tester le film lors de l’assaut final. Hockaleuk visionna les six heures de batailles des dizaines de fois, supervisa chaque blessure fictive. Il était sûr que les soldats en regardant le film seraient persuadés de perdre la bataille, voir même convaincu d’être déjà mort. Pour le réalisateur son film allait renverser le cours de la bataille.
– Il reste encore un des écrans sur l’avenue Thiers, non ?
-Oui mais je doute qu’il fonctionne encore.
– Sa stratégie n’a pas fonctionné, l’Aquitaine a perdu cette bataille il me semble?
Le général sourit, content de voir que ses leçons d’histoire n’étaient pas inutiles.
– Malheureusement pour le réalisateur, les armées des volcans profitèrent des travaux sur les écrans pour faire une percée dans les défenses. Les gardes étaient trop occupés à faire fonctionner les télévisions géantes pour repousser l’ennemi.
– Et Hockaleuk ?
– Tu ne t’étais jamais demandé qui était le cadavre écartelé sur l’écran avenue Thiers ?
Le général lâcha sa fléchette qui alla se planter dans l’œil droit du médecin fou.
***